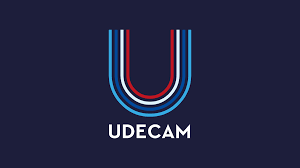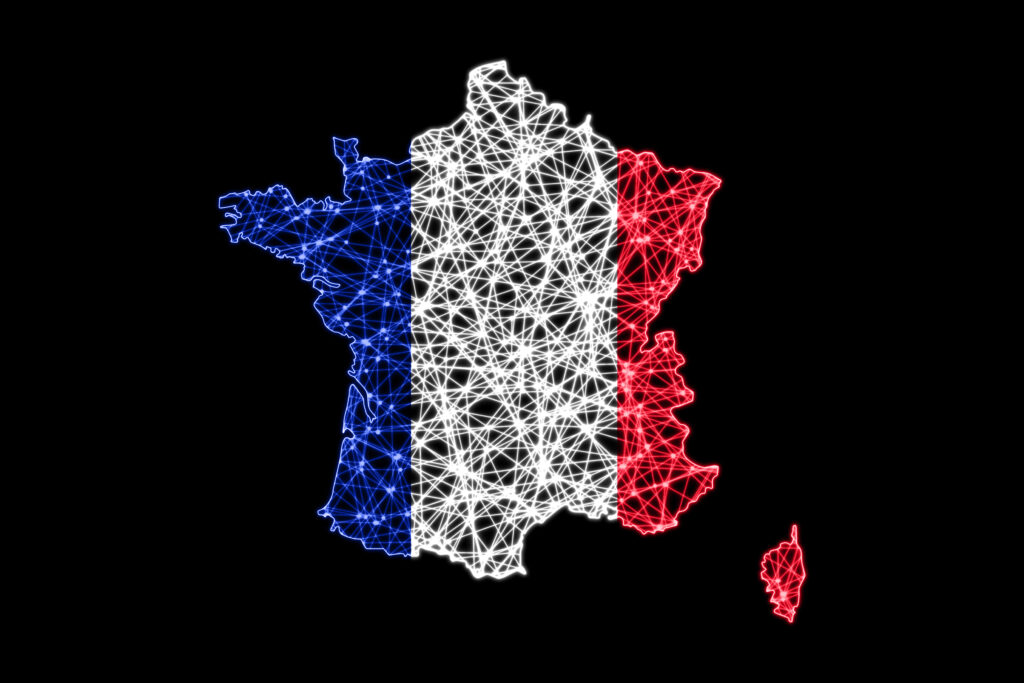
L’étude menée par l’association Les Relocalisateurs et la Fondation Jean-Jaurès met en lumière la progression des « déserts médiatiques » en France et les risques afférents, notamment sur la santé démocratique du pays.
Fondée sur une enquête de plus de 10 000 répondants, enrichie par des analyses d’experts et un reportage de terrain mené par deux journalistes, l’étude montre combien l’accès à une information fiable et diversifiée conditionne la solidité du lien social, la participation citoyenne, l’intérêt pour le débat public et la compréhension des enjeux collectifs.
Dans un paysage marqué par la fragilisation économique des médias, la disparition progressive de rédactions locales, la concentration des acteurs et la dépendance accrue aux plateformes numériques, en particulier les réseaux sociaux, l’étude souligne qu’une partie croissante du territoire est aujourd’hui exposée voit s’effriter un écosystème informatif pluraliste, enraciné et accessible alors qu’il est pourtant un pilier essentiel du fonctionnement démocratique.
L’enquête observe en particulier les médias locaux et leur rôle central dans la vitalité démocratique : plus les citoyens s’informent, plus ils participent et adhèrent aux valeurs démocratiques. Quelques enseignements clés :
- Les Français restent majoritairement attachés aux médias traditionnels, même si les réseaux sociaux progressent, surtout chez les jeunes ;
- 55 % consomment au moins un média local, apprécié pour sa proximité, sa fiabilité relative et la pluralité de points de vue ;
- La consommation médiatique varie fortement selon les territoires, plus élevée dans le Sud, la Bretagne et l’Alsace, plus faible dans le Nord-Est et certaines périphéries franciliennes ;
- Une corrélation nette existe entre offre de médias locaux et niveau de consommation : là où l’offre diminue, l’attention à l’information recule ;
- Les consommateurs intensifs de médias votent davantage, s’engagent plus dans la vie locale et portent plus fortement les valeurs citoyennes,
- A contrario, les non-consommateurs sont plus abstentionnistes, plus défiants et davantage exposés aux croyances complotistes ;
- La perception du personnel politique est dégradée partout, indépendamment du niveau d’information ;
- Les cartes prospectives montrent qu’une baisse de 20 points de la consommation médiatique ferait chuter significativement participation électorale et adhésion aux valeurs démocratiques ;
- L’étude alerte ainsi sur le risque de véritables « déserts médiatiques », où le recul de l’information fragilise le lien social, la cohésion territoriale et la démocratie elle-même.
Ces constats invitent à prendre au sérieux les fragilités qui s’installent : recul de certaines rédactions, inégalités territoriales d’accès à l’information, dépendance croissante aux plateformes et brouillage des repères dans un environnement numérique saturé.
En mettant en évidence le rôle structurant des médias locaux dans l’engagement citoyen, la participation électorale et le maintien d’un débat public éclairé, cette étude offre un cadre précieux pour repenser les priorités collectives. Elle ouvre ainsi la voie à une réflexion sur les conditions à réunir, qu’elles soient économiques, politiques et culturelles, pour soutenir un paysage médiatique pluraliste, ancré dans les territoires et à même d’accompagner les transitions démocratiques à venir.